Panne !
En pause pour… quelques temps !

Pour cause de panne d′inspiration.
La maison… assassinée !
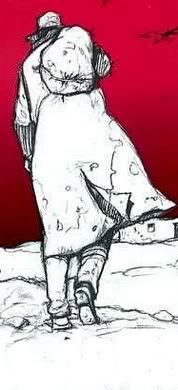
Ce matin le monde ne s’est pas réveillé.
Et depuis la maison gît comme morte, assassinée.
Ils lui ont dit que ce n’était pas de sa faute, qu’elle n’avait rien à se reprocher. Les mots vides de sens tournent dans son cerveau, et c’est comme si elle ne les avait jamais compris. Ce qu’elle sait, cependant, c’est qu’elle ne reviendra jamais. Et elle leur a expliqué, à tous ces gens, pourtant, ils n’ont rien voulu entendre. La surdité les a comme atteint, alors au lieu de leur expliquer, elle a préféré se murer dans le silence. C’est tellement plus aisé.
On est venu lui annoncer l’impensable.
Sa fille a été retrouvée allongée sur le sol, son scooter dans le fossé et son sac sur le dos. Décédée.
Alice a ouvert de grands yeux. Son scooter, c’était elle qui le lui avait acheté. Pour la réussite de son bac, la seule condition pour laquelle son enfant aurait le droit de poursuivre la musique.
Pour le bac. Il y’avait là de quoi en rire.
Elle s’est assise. De ses yeux les larmes n’ont pas coulé. Sous le choc assurément, a-t-on pensé. Mais en face des policiers, elle disait : c’est ma faute.
C’est moi qui voulais qu’elle soit quelqu’un, qu’elle ne se limite pas à une passade de jeunesse, moi qui voulais qu’elle les dépasse tous, qu’elle soit la meilleure en cours. J’attendais qu’elle ait une mention à son diplôme, qu’elle me prouve qu’elle savait rédiger autre chose que des notes sur des vieux morceaux de papier. Ce scooter, ce n’était pas pour elle. C’était juste pour que je puisse être fière d’elle, fière de ma petite fille, avec son très bien et son talent pour la musique. Douée dans tous les domaines.
Et on la félicitait.
C’est moi qui l’ai tué.
De là où elle se trouve, Alice peut voir la mer.
Ses grands yeux bleus se ferment, pour ainsi mieux profiter du bruit des vagues. Elle les sent même s’écraser sur le sable dorée. C’est si joli d’en imaginer leurs arrivées dans un lieu ignoré, elles qui n’ont connus que la grandeur de l’océan. Elles se soulèvent jusqu’à atteindre leur apogée ; et au moment où elles s’y attendaient le moins, à l’instant où elles touchent presque le ciel, elles retombent vers des terres inconnues. Elle ne s’est jamais lassée de ces images qui tournent en boucle dans sa tête.
Et lorsque le soir s’invite dans le paysage, l’odeur de la nuit se mêle à celui salée des embruns. Le parfum est entêtant, elle a parfois l’impression que ce goût emplie sa bouche toute entière. Il lui rappelle le goût du sang, amer, comme quand elle se mort l’intérieur de la gencive. Même son mari, une fois où il l’a embrassé, a avoué qu’il faut qu’elle arrête cette mauvaise habitude, car lui aussi en gardait le souvenir à l’issue de leur baiser.
C’est curieux que la mer lui rappelle ce vague détail.
Ainsi, allongée sur le lit, elle est bien.
Il est si dommage que cette foule qui l’appelle l’empêche de pouvoir mieux savourer le déchaînement de la houle sur la plage. Mais Alice veut rester où elle se trouve. Elle ne veut pas participer à la fête où ces autres l’obligent à aller.
“Tu penses qu’elle se réveillera un jour et qu’elle cessera de se terrer dans son trou je ne sais pas le médecin qui l’a ausculté pense que c’est juste elle…”.
Ces brises de mots n’ont aucune signification. Ils parlent d’elle, mais elle est ailleurs.
En compagnie d’une mer qui enfin réussi à la comprendre.
Dans sa main elle tient trois petits bouts de bois, et c’est tout ce qui lui reste de sa fille. Sa toute, toute petite fille. Ces morceaux, c’est sa fille enfant, c’est sa fille plus grande. “Dis maman, je pourrais faire de la musique plus tard ?”. Et elle lui répétait inlassablement “Tu sais, c’est difficile de travailler dans ce milieu.” On n’explique pas à un enfant que ce n’est pas sûr et que pour ne pas souffrir, il fallait qu’elle choisisse un métier sérieux. Elle ne voulait que son bien, puisqu’elle était son unique enfant.
“-Alice, il faudrait que tu ranges sa chambre, maintenant.”
Elle s’est remise à parler, depuis quelques temps. Juste pour l’essentiel. Au travers de ses lèvres pincés n’est passé qu’un faible oui, brisé.
Il va bien falloir qu’elle s’y mette. Cela fait près de six mois, maintenant. Et elle n’a aucune envie qu’ils touchent ses objets de leurs mains sales d’inconnus. Sa fille ne l’aurait pas voulu, contrairement à ce qu’ils pensent. Avec leurs mains glacées, ils iraient tout détruire, ils iraient tout salir.
Elle leur répond plus tard, il lui faut du temps. Au moins encore un peu.
Le temps passe.
Des nuages cotonneux se sont déposés sur les arbres. L’hiver va bientôt pointer le bout de son nez – le métronome poursuit son inlassable routine.
Alice ne sait plus où elle en est.
Depuis qu’elle est partie, son esprit est tout empli de blancs qu’il lui faut combler dès à présent.
Un jour ses pieds ont grimpé les marches, seuls, mus par leur volonté propre. Les marches ont craqué sous le poids des heures.
Elle aurait dû penser à appeler un ébéniste. Sa fille le lui rappelait souvent. A force d’emmagasiner toute ce moisi, cet escalier va pourrir.
Quand elle était enfant, sa fille courrait dans cet escalier, un sourire au creux des lèvres. Parfois, ses mains saignaient d’avoir trop joué dans la journée. “Maman, maman, la prof de musique m’a appris à jouer un morceau de Bach !”. Dans son adolescence, ses cris envahissaient la pièce jusqu’à s’incruster dans les murs, et la porte claquait dans un battement sourd.
Maintenant, la maison reste toujours silencieuse.
La maison est morte.
Et elle reste au seuil de la chambre, avec son souffle court et sa douleur au cœur, sauf qu’aujourd’hui, personne ne viendra lui ouvrir la porte.
Via CherubCampus !
Image et citation du… dimanche !

Il semble donc exister trois niveaux d’organisation de l’action. Le premier, le plus primitif, à la suite d’une stimulation interne et/ou externe, organise l’action de façon automatique, incapable d’adaptation. Le second organise l’action en prenant en compte l’expérience antérieure, grâce à la mémoire que l’on conserve de la qualité, agréable ou désagréable, utile ou nuisible, de la sensation qui en est résultée. L’entrée en jeu de l’expérience mémorisée camoufle le plus souvent la pulsion primitive et enrichit la motivation de tout l’acquis dû à l’apprentissage. Le troisième niveau est celui du désir. Il est lié à la construction imaginaire anticipatrice du résultat de l’action et de la stratégie à mettre en œuvre pour assurer l’action gratifiante ou celle qui évitera le stimulus nociceptif. Le premier niveau fait appel à un processus uniquement présent, le second ajoute à l’action présente l’expérience du passé, le troisième répond au présent, grâce à l’expérience passée par anticipation du résultat futur.
Éloge de la fuite — Henri Laborit est né le 21 novembre 1914 à Hanoï, alors en Indochine, et mort le 18 mai 1995 à Paris. Médecin chirurgien et neurobiologiste, il introduisit l′utilisation des neuroleptiques en 1951. Il était également éthologue (spécialiste du comportement animal), “eutonologue”, selon sa propre définition (spécialiste du comportement humain) et philosophe. Il s′est fait connaître du grand public par la vulgarisation des neurosciences, notamment en participant au film Mon oncle d′Amérique d′Alain Resnais.— Plus sur WikiPedia.
La mère des… contes !

Où sont donc nés les contes, et pourquoi, et comment ? Une femme l′a su, aux premiers temps du monde. Qui l′a dit à la femme ? L′enfant qu′elle portait dans son ventre. Qui l′a dit à l′enfant ? Le silence de Dieu. Qui l′a dit au silence ?
Il était pour la première fois, dans la grande forêt des premiers temps, un rude bûcheron et son épouse triste. Ils vivaient pauvrement dans une maison basse, au cœur d′une clairière. Ils n′avaient pour voisins que des bêtes sauvages et ne voyaient passer, dehors, par la lucarne, que vents, pluies et soleils. Mais ce n′était pas la monotonie des jours qui attristait la femme de cet homme des bois et la faisait pleurer, seule, dans sa cuisine. De cela elle se serait accommodée, bon an, mal an. Hélas, en vérité, son mari avait l′âme aussi broussailleuse que la barbe et la tignasse. C′était cela qui la tourneboulait. Caressant, il l′était comme un buisson d′épines, et quand il embrassait en grognant sa compagne, ce n′était qu′après l′avoir battue. Tous les soirs il faisait ainsi, dès son retour de la forêt. Il poussait la porte d′un coup d′épaule, empoignait un lourd bâton de chêne, retroussait sa manche droite, s′approchait de sa femme qui tremblait dans un coin, et la rossait. C′était là sa façon de lui dire bonsoir.
Passèrent mille jours, mille nuits, mille roustes. L′épouse supporta sans un mot de révolte les coups qui lui pleuvaient chaque soir sur le dos. Vint une aube d′été sur la clairière. Ce matin-là, comme elle regardait son homme s′éloigner sous les grands arbres, sa hache en bandoulière, elle posa les mains sur ses hanches et pour la première fois depuis le jour de ses épousailles elle sourit. Elle venait à l′instant de sentir une vie nouvelle bouger là, dans son ventre. "Un enfant !" pensa-t-elle, tremblante, émerveillée. Mais son bonheur fut bref, car lui vint aussitôt plus d′épouvante qu′elle n′en avait jamais enduré. "Misère, se dit-elle, qui le protégera si mon mari me bat encore ? En me cognant dessus, il risque de l′atteindre. Il le tuera peut-être avant qu′il ne soit né. Comment sauver sa vie ? En n′étant plus battue. Mais comment, Seigneur, ne plus être battue ?" Elle réfléchit à cela tout au long du jour avec tant de souci, de force et d′amour neuf pour son fils à venir qu′au soir elle sentit germer une lumière.
Elle guetta son homme. Au crépuscule il s′en revint, comme à son habitude. Il prit son gros bâton, grogna, leva son bras noueux. Alors elle lui dit :
– Attends, mon maître, attends ! J′ai appris aujourd′hui une histoire. Elle est belle. Écoute-la d′abord, tu me battras après.
Elle ne savait rien de ce qu′elle allait dire, mais un conte lui vint. Ce fut comme une source innocente et rieuse. Et l′homme demeura devant elle captif, si pantois et content qu′il oublia d′abattre son bâton sur le dos de sa femme. Toute la nuit elle parla. Toute la nuit il l′écouta, les yeux écarquillés, sans remuer d′un poil. Et quand le jour nouveau éclaira la lucarne, elle se tut enfin. Alors il poussa un soupir, vit l′aube, prit sa hache et s′en fut au travail.
Au soir gris, il revint. Elle l′entendit pousser la porte à grand fracas. Elle courut à lui.
– Attends, mon maître, attends ! Il faut que je te dise une nouvelle histoire. Écoute-la d′abord, tu me battras après !
A l′instant même un conte neuf naquit de sa bouche surprise. Comme la nuit passée son époux l′écouta, l′œil rond, le poing tenu en l′air par un fil invisible. Le temps parut passer comme un souffle. A l′aube elle se tut. Il vit le jour, se dit qu′il lui fallait partir pour la forêt, prit sa hache, et s′en alla.
Et quand le soir tomba vint encore une histoire. Neuf mois, toutes les nuits, cette femme conta pour protéger la vie qu′elle portait dans le ventre. Et quand l′enfant fut né, l′homme connut l′amour. Et quand l′amour fut né, les contes des neuf mois envahirent la terre. Bénie soit cette mère qui les a mis au monde. Sans elle les bâtons auraient seuls la parole.
Henri Gougaud, L′arbre d′amour et de sagesse, 1992.
Le clou… magique !

Quand Jean-Baptiste vit la jument devant la porte de la forge, il ne fut pas surpris outre mesure. Sans doute son propriétaire voulait-il qu’on la ferrât et avait-il eu autre chose à faire que d’attendre le retour du maréchal-ferrant. Jean-Baptiste actionna le grand soufflet de forge pour relancer le feu. Il choisit soigneusement quatre nouveaux fers. Il les mit à chauffer. Il entreprit d’ôter les fers usagés.
Poser les trois premiers fers n’entraîna rien d’exceptionnel. Quand le maréchal-ferrant retira le dernier, celui de la patte arrière droite, il vit que l’un des clous était un clou... en OR ! Jean-Baptiste remplaça le fer, il y mit de bons gros clous ordinaires. La jument hennit pour remercier l’homme. Elle s’éloigna en trottinant. S’estimant assez payé de sa peine par le clou en or, le maréchal-ferrant mit celui-ci dans sa poche. Il n’y pensa plus !
Sa journée faite, le maréchal-ferrant le soir regagna son logis. La Ginette l’attendait avec d’autant plus d’impatience que depuis un bon quart d’heure elle n’avait eu personne à qui parler. La femme du forgeron, presque aussi haute et large d’épaules que lui, avec ses grosses mains rougies par l’eau du lavoir, était une brave femme, certes, et Jean-Baptiste l’aimait, mais elle était la plus bavarde des bavardes de Caissargues. Lorsqu’elle se rendait au lavoir, sa langue s’activait tout autant que ses gros bras qui lavaient, qui frappaient le linge à grands coups de battoir, qui le frictionnaient énergiquement avec le gros savon de Marseille et la brosse en chiendent, qui le lavaient de nouveau, qui le frappaient une nouvelle fois, qui le rinçaient, qui l’essoraient... Elle allait vite et bien en besogne. Pendant qu’avec les autres commères lavandières elle faisait et défaisait les réputations, répétait ce qu’elle savait, ce qu’on lui avait rapporté. Ce qu’elle ne savait pas, eh bien elle l’inventait ! Jamais fatiguée, tous les soirs elle racontait à son homme sa journée par le menu. Brodant, enjolivant, Ginette était intarissable. Jean-Baptiste soupirait, il la laissait parler, priant le ciel qu’une fois, une toute petite fois, elle eut une extinction de voix, durant une toute petite heure, ou même quelques minutes... Mais non. Hiver comme été Ginette n’était jamais malade ! Le maréchal-ferrant avait beau supplier, menacer, rien n’y faisait.
Ginette le regardait.
- Tu ne me crois pas ?
Puis elle recommençait. Ce jour-là Jean-Baptiste claqua sa main contre sa cuisse, à l’endroit où se trouvait le clou en or dans le pantalon. Il soupira.
- Pauvre de moi, je voudrais que tu te taises...
Oh miracle ! Ginette roulait de grands yeux effrayés, elle avait beau ouvrir la bouche, aucun son articulé n’en sortait... Jean-Baptiste s’étonna. Il prit tout le temps d’apprécier le silence, puis voyant sa femme malheureuse pleurant toutes les larmes de son corps, sans faire le moindre bruit, il eut pitié d’elle - je vous ai dit qu’il l’aimait. Il se dit que, peut-être, « Pauvre de moi ! » était un mot magique, que le clou en or n’était pas un clou en or ordinaire...
- Pauvre de moi, je voudrais que tu reparles !
Voilà Ginette tellement heureuse de pouvoir s’exprimer de nouveau qu’elle courut chez la voisine annoncer qu’elle avait bien failli ne plus parler du tout. Comme elle avait de la parole en retard, elle oublia l’heure du souper !
Resté seul, affamé, Jean-Baptiste résolut de se préparer à manger. Il se tapa la cuisse à l’endroit du clou magi-que, et dit.
- Pauvre de moi, je voudrais un poulet rôti !
Me croirez-vous ? Voilà qu’un succulent poulet trônait au milieu de la table. Jean-Baptiste entreprit de lui faire un sort. Il finissait le dernier morceau de blanc, quand Ginette revint ! La commère comprit que son extinction de voix n’était peut-être pas aussi naturelle que ça. Elle questionna son homme sur ce poulet-là.
À toutes ses questions, Jean-Baptiste répondait.
- Tu parles trop. Si je te disais quoi que ce soit, demain tout le village serait au courant !
Ginette eut beau promettre, jurer, pleurer, supplier. Le maréchal-ferrant restait inflexible !
La lavandière ne se tint pas pour battue. Elle se rappela que son homme parlait souvent dans son sommeil. Cette nuit-là, elle entreprit de veiller. Quand elle entendit les premiers ronflements, elle questionna le maréchal-ferrant... Jean-Baptiste parla !
Pour une fois, Ginette se dit que ce secret-là ne devait pas être ébruité. Elle en parlerait juste à Marie, sa meilleure amie, sa presque sœur. Cette dernière confia le secret de Jean-Baptiste à son autre meilleure amie. De meilleure amie en presque soeur, de voisine en vague connaissance, le lendemain soir chacun à Caissargues savait tout du secret du maréchal-ferrant... Chacun, et surtout Hector, le bouilleur de cru. Cet homme-là était laid, méchant, il n’était pas aimé, il s’amusait à faire peur aux enfants. On le disait un rien sorcier. Si on avait recours à ses services, c’est que l’alambic qu’il promenait de village en village, était le seul à vingt lieues à la ronde, qu’on aimait offrir, se voir offrir, de temps à autre, un petit verre d’eau de vie... La jument, la fameuse jument au clou en or, c’était la sienne ! Depuis sa fugue de la veille, Hector avait beau frotter son sabot arrière droit en disant.
- Pauvre de moi, je veux de l’or ! Pauvre de moi, je veux à boire ! Pauvre de moi, je veux manger !
Il ne se produisait plus rien... Voilà donc le mystère éclairci, et Hector pressé de récupérer le clou magique !
Il se dit que le mieux serait d’attendre la nuit, que le maréchal-ferrant ôtât son pantalon... Comment entrer dans la maison ? Hector eut une idée. Il se rendit devant la forge. Là, il se transforma en chemise. Il s’attendait à ce que le forgeron la ramassât. Elle était à sa taille, l’homme la poserait sans doute à côté du pantalon. Le tour serait joué ! Ce que le bouilleur de cru n’avait pas prévu, c’est que Ginette passât par là. Elle vit la chemise, elle se dit que celle-ci irait à son homme. Comme elle ignorait qui l’avait portée, elle préféra retourner au lavoir... Avec ses gros bras, Ginette lava la chemise, elle la frappa à grands coups de battoir, elle la frictionna au savon de Marseille et à la brosse en chiendent, elle la lava de nouveau, elle la frappa une nouvelle fois avec son battoir, elle la rinça abondamment, pour finir elle l’essora... La chemise disparut !
On retrouva le corps du bouilleur de cru à côté de sa jument et de son alambic. On vit bien qu’il avait été battu, noyé, frictionné jusqu’à ce qu’on l’eût écorché, qu’on lui avait brisé les os, qu’à la fin on lui avait tordu le cou. On ne sut jamais qui avait fait le coup !
Via Contes pour tous !
Image et citation du… dimanche !

Rarement la beauté et le je ne sais quoi se trouvent ensemble. J’entends par le je ne sais quoi : ce charme répandu sur un visage et sur une figure, et qui rend une personne aimable, sans qu’on puisse dire à quoi il tient.
Le Cabinet du philosophe / Journaux et Œuvres diverses — Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, communément appelé Marivaux, baptisé le 8 février 1688 à Paris où il est mort le 12 février 1763, est un écrivain français. Homme solitaire et discret à la personnalité susceptible, longtemps mal compris1, il fut un journaliste, un romancier, mais surtout un auteur dramatique fécond qui, amoureux du théâtre et de la vérité, observait en spectateur lucide le monde en pleine évolution et écrivit pour les Comédiens italiens, entre 1722 et 1740, des comédies sur mesure et d’un ton nouveau, dans le langage “de la conversation”. Il est, après Molière, Racine, Pierre Corneille et Musset le cinquième auteur le plus joué par la Comédie française.— Plus sur WikiPedia.
Un petit conte de… Sagesse !

Un jour, dans un village guarani, le vieux chef vint à mourir et les deux meilleurs guerriers commencèrent à se disputer la succession.
Le premier disait:
— “Je suis le plus fort de tous! Je n’ai jamais eu peur de rien, et je dois être choisi pour ces raisons.”
Le second affirmait:
— “Moi aussi je n′ai jamais eu peur, et de plus je sais parler aux oiseaux : c’est moi qui doit être choisi.”
Chacun des deux hommes avait ses partisans dans le village,
les discussions devenaient de plus en plus animées, de plus en plus violentes, et le doyen de la tribu décida d’intervenir avant que les deux clans en viennent à sortir les armes.
Le vieil homme fit venir un autre guerrier, celui qui tirait le mieux à l’arc, et lui demanda de décocher deux flèches dans la jungle, le plus loin possible. Puis il se tourna vers les deux prétendants et leur dit:
— “Je désignerai chef celui qui sera le premier à me ramener une de ces flèches.”
Les deux hommes disparurent aussitôt en courant dans la jungle, et les villageois restèrent à attendre que la décision se fasse.
Les heures passèrent, et au moment où le soleil disparaissait derrière les arbres, on vit revenir les deux guerriers, ensemble, tenant chacun une des flèches.
Le doyen décida donc, dès le lendemain matin, de leur donner une nouvelle épreuve. Il les emmena au bord de la rivière, là où le courant était le plus fort, le plus tumultueux, et leur dit:
— “Vous avez une heure, jusqu’à ce que le soleil arrive à son zénith, pour pêcher le plus gros poisson possible.”
Les deux hommes plongèrent aussitôt sous les yeux des villageois qui les encourageaient en les regardant se débattre dans les flots.
Mais lorsque l’heure se fut écoulée, ils ressortirent ensemble de l’eau, avec des prises qui s’avérèrent parfaitement égales en taille et en poids.
Il était encore une fois impossible de prendre une décision.
Le soir même, le doyen les emmena vers un endroit où poussaient deux énormes orangers.
Il leur dit:
— “Vous avez une heure, jusqu’au coucher du soleil, pour cueillir le plus de fruits possible sans en laisser tomber un seul à terre.”
Les deux hommes grimpèrent dans les arbres et commencèrent à cueillir les oranges sous les cris de la foule, jetant les fruits dans de grands paniers posés au pied des arbres.
Le soleil se coucha, les paniers remplis d’oranges furent soigneusement examinés, pour en arriver à la triste conclusion que les paniers pesaient le même poids et contenaient le même nombre de fruits.
Cette fois-ci le doyen s’avoua vaincu :
— “Je n’ai plus d’épreuves à faire passer donc je ne sais toujours pas qui doit être chef.”
Les discussions entre les deux clans reprirent dès l’aube, plus vives que jamais, et les couteaux jaillirent soudain des fourreaux.
Mais à cet instant, un vieil homme apparut au milieu de la foule.
Les villageois s’inclinèrent, reconnaissant tout de suite l’incarnation de Tupa l’Esprit du Bien.
L′ange s’adressa d’abord au doyen, le remerciant de ses efforts, mais lui faisant également remarquer qu’il avait oublié ce qui était peut-être la plus importante de épreuves: celle de la sagesse.
Il invita donc les deux prétendants à le suivre dans la jungle pour qu’une décision puisse enfin être prise.
A la suite de l′ange, ils marchèrent des heures durant, ne sachant où ils allaient, jusqu’au moment où Tupa se pencha à terre et ramassa quelque chose. Il se retourna, sa main tendue vers eux, et leur dit:
— “Regarder attentivement le papillon dans ma main, parce que c′est un papillon magique, qui ne peut être vu que par les hommes sages.”
Tupa demanda donc au premier guerrier s’il voyait l’insecte:
— “Oui!” dit l′homme.
Tupa se tourna vers le second homme et lui posa la même question.
Le guerrier resta longuement silencieux et finit par répondre:
— “Je ne vois rien.”
Tupa sourit et lui dit:
— “Ce sera toi le chef, car il n’y avait effectivement rien à voir dans ma main et tu as eu la sagesse de t’en tenir à la stricte vérité même si elle allait contre toi”.
On dit que ce fut l’un des meilleurs chefs que les Guaranis aient jamais connus, avec un règne qui s’avéra long et prospère. Et l’on dit aussi que cet homme si sage était celui qui savait parler aux oiseaux.
Via les contes de ForumActif !
L’autographe… homicide !

J’étais resté absent de Paris pendant quelques mois, fort pris par un voyage d’exploration dans la région nord-ouest de Courbevoie.
Quand je rentrai à Paris, des lettres s’amoncelaient sur le bureau de mon cabinet de travail ; parmi ces dernières, une, bordée de noir.
C’est ainsi que j’éprouvai la douloureuse stupeur d’apprendre le décès de mon pauvre ami Bonaventure Desmachins, trépassé dans sa vingt-huitième année.
– Comment, m’écriai-je, Desmachins ! Un garçon si bien portant, si vigoureusement constitué !
Mais quand j’appris, quelques heures plus tard, de quoi était mort Desmachins, ma douloureuse stupeur fit alors place à un si vif épatement que j’en tombai de mon haut (2 m 08).
– Comment, me récriai-je, Desmachins ! Un garçon si rangé, si vertueux !
Le fait est que la chose paraissait invraisemblable.
Pauvre Desmachins ! Je le vois encore si tranquille, si bien peigné, si bien ordonné dans son existence.
Il avait bien ses petites manies, parbleu ! mais qui n’a pas les siennes ?
Par exemple, il n’aurait pas, pour un boulet de canon, acheté un timbre-poste ailleurs qu’à la Civette du Théâtre- Français. Il prétendait qu’en s’adressant à cette boutique, il réalisait des économies considérables de ports de lettres, les timbres de la Civette étant plus secs, par conséquent plus légers et moins idoines à surcharger la correspondance.
Innocente manie, n’est-il pas vrai ?
Si Desmachins n’avait eu que ce petit faible, il vivrait encore à l’heure qu’il est. Malheureusement, il avait une passion d’apparence non dangereuse, mais qui, pourtant, le conduisit à la tombe.
Desmachins collectionnait les autographes.
Il les collectionnait comme la lionne aime ses petits : farouchement.
Et il en avait, de ces autographes ! Il en avait ! Mon Dieu, en avait-il !
De tout le monde, par exemple : de Napoléon Ier, d’Yvette Guilbert, de Chincholle, de Henry Gauthier-Villars, de Charlemagne…
Il est vrai que celui de Charlemagne !… J’en savais la provenance, mais, pour ne point désoler Desmachins, je gardai toujours, à l’égard de ce parchemin faussement suranné, un silence d’or.
(C’était un vieil élève de l’École des chartes, tombé dans une vie d’improbité crapuleuse, qui s’était adonné à la fabrication de manuscrits carlovingiens – ne pas écrire carnovingiens – et qui fournissait à Desmachins des autographes des époques les plus reculées)
L’ami qui m’apprenait le trépas de Desmachins, en tous ses pénibles détails, semblait lutter contre un désir d’aveu.
À la fin, il murmura : – Et ce qu’il y a de plus terrible, c’est que je suis un peu son assassin.
Du coup, ma douloureuse stupeur se teinta d’étonnement.
– Oui continua-t-il, le pauvre Desmachins est mort sur mon conseil !
– Le guillotiné par persuasion, quoi !
– Oh ! ne ris pas, c’est une épouvantable histoire, et je vais te la conter.
Je pris l’attitude bien connue du gentleman à qui on va conter une épouvantable histoire, et mon ami – car, malgré tout, c’est encore mon ami – me narra la chose en ces termes :
– Un jour, je rencontrai Desmachins enchanté d’une nouvelle acquisition. Il venait d’acheter un os de mouton sur lequel était inscrit, de la main même du Prophète, un verset du Coran.
– Et tu as payé ça ?… lui demandai-je.
– Une bouchée de pain, mon cher. C’est un vieux cheik arabe qui me l’a cédé. Comme il avait absolument besoin d’argent, j’ai pu avoir l’objet pour 3000 francs.
Mâtin ! pensai-je, 3000 francs, une bouchée de pain ! Ça le remet cher la livre !
Et il m’emmena chez lui pour me faire admirer son nouveau classement. Il avait, disait-il, inventé un nouveau classement dont il était très fier.
La vue d’une lettre de Nélaton me suggéra une idée et, machinalement, je lui demandai :
– Tu n’as pas d’autographe de Ricord ?
– Ricord ?… Qui est-ce ?
– Comment ! tu ne connais pas Ricord ?
Le malheureux… c’est-à-dire, non, le bienheureux… ou plutôt non, le malheureux ne connaissait pas Ricord.
Alors, moi, je lui dis la gloire de Ricord, et Desmachins résolut aussitôt d’avoir, en sa collection, un mot du célèbre spécialiste.
Dès le lendemain, il alla chez ses fournisseurs ordinaires : pas le moindre Ricord.
Chez ses fournisseurs extraordinaires, pas davantage.
Desmachins se désolait, s’impatientait. Car lui, si calme d’habitude, tournait facilement au fauve lorsqu’il s’agissait de sa collection.
– Pourtant, rugissait-il, il y a des gens qui en ont, de ces autographes !
– Oui, répliquai-je avec douceur, mais ceux qui les détiennent sont plus disposés à les enfouir dans les plus intimes replis de leur portefeuille qu’à en tirer une vanité frivole
– Tu me donnes une idée ! Puisque Ricord est médecin, je vais aller le trouver, il me fera une ordonnance qu’il signera, et j’aurai un autographe !
– C’est ingénieux, mais malheureusement… ou plutôt heureusement, tu n’es pas malade.
– J’ai un fort rhume de cerveau… Tu vois, mon nez coule.
– Ton nez…
Je n’achevai pas, ayant toujours eu l’horreur des plaisanteries faciles, mais j’éclairai Desmachins sur le rôle de Ricord dans la société contemporaine.
Huit jours se passèrent.
Un matin, Desmachins entra chez moi, pâle mais les yeux résolus.
– Tu sais, j’y suis décidé !
– À quoi ?
– À aller chez Ricord.
– Mais, encore une fois, tu n’es pas… malade.
– Je le deviendrai !… Et précisément, je viens te demander des détails.
Je crus qu’il plaisantait, mais pas du tout ! C’était une idée fixe
Alors – et ce sera l’éternel remords de ma vie – j’eus la faiblesse de lui fournir quelques explications. Je lui conseillai les Folies Bergère, par expérience.
La semaine d’après, Desmachins m’envoyait un petit bleu ainsi conçu :
»Viens me voir. Je suis au lit. Mais qu’importe ! JE L’AI !
Les trois derniers mots triomphalement soulignés.
Oui, termina tristement le narrateur, il l’avait, et c’est de ça qu’il est mort
Contes humoristiques — Alphonse Allais que je n′avais pas cité depuis longtemps— Plus sur WikiPedia.
Image et citation du… dimanche !
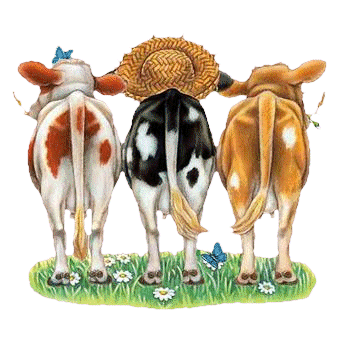
Si l’union fait la force, la force n’a jamais fait l’intelligence
La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute — Pierre Desproges, né le 9 mai 1939 à Pantin, mort le 18 avril 1988, à Paris, est un humoriste français réputé pour son humour noir, son anticonformisme et son sens de l′absurde.— Plus sur WikiPedia.
Le secret du… bonheur !

Un enfant demande à son père :
— Dis papa, quel est le secret pour être heureux ?
Alors le père demande à son fils de le suivre. Ils sortent de la maison, le père sur leur vieil âne et le fils suivant à pied. Et les gens du village de dire:
— Mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils d′aller à pied !
— Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison, dit le père.
Le lendemain ils sortent de nouveau, le père ayant installé son fils sur l′âne et lui marchant à côté. Les gens du village dirent alors:
— Quel fils indigne, qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied !
— Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.
Le jour suivant ils s′installent tous les deux sur l′âne avant de quitter la maison. Les villageois commentèrent en disant:
— Ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi!
— Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.
Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires, l′âne trottinant derrière eux. Cette fois les gens du village y trouvèrent encore à redire:
— Voilà qu′ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant ! C′est le monde à l′envers !
— Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.
Arrivés à la maison, le père dit à son fils:
— Tu me demandais l′autre jour le secret du bonheur.
Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu′un pour y trouver à redire.
Fais ce qui te plaît et tu seras heureux.
Conte africain !
Hêtre ou… ne pas être !

C’était mon nouvel arbre, un beau hêtre de taille moyenne. Je venais de l’acheter et de le planter dans le fond de mon jardin afin d’égayer ce côté assombri par les murettes qui l’entouraient.
Tous les jours, je venais l’observer, vérifier qu’il n’était pas malade. Son écorce rugueuse et plissée faisait penser à des rides de vieille femme. Deux petites encoches dans son écorce rappelaient des yeux tristes. A chaque fois que je m’approchais de lui, je le touchais, faisant le tour de son tronc. Et quand je passais devant les deux petits creux, je m’arrêtais, les épiant, essayant de percevoir un message. Ses feuilles, d’un vert apaisant, bruissaient dans le vent. Une mélodie s’installait.
Un matin, je me réveillai et allai voir comme d’habitude mon arbre. Ses branches pendaient, touchant presque le tronc. Une grande partie des feuilles étaient au sol, recouvrant ses racines apparentes. Je devins anxieux. Sûrement avait-il fait très froid cette nuit là ! Une gelée avait pu faire tomber les feuilles et s’affaisser les branches. Ce petit moment d’effroi m’avait mis mal à l’aise. Je me calmais doucement.
Soudain, un vent glacé me monta le long de la colonne vertébrale, l’arbre semblait déplacé. Etait-ce une plaisanterie? Quelqu’un aurait déraciné puis replanté mon arbre ?
Je restais là, tétanisé, ne pouvant articuler un mot. J’essayais de me raisonner, de trouver une explication. Des mots se bousculaient dans ma tête. L’angoisse accélérait mon souffle.
Je tentais de reprendre peu à peu mes esprits pour ne pas vaciller, quand l’arbre se mit à sortir ses racines de la terre. Les petits creux dessinèrent un rictus sournois. Les branches se relevèrent et se tendirent comme si elles se préparaient à m’attraper. Quant à moi, ne pouvant bouger, je regardais l’arbre s’approcher lentement, inexorablement.
Je ne sais plus où je l′ai trouvée cette histoire.
Yoga pour… Enfants !

Tu imagines :
Tu es une cigogne qui se tient sur une patte, là-haut, dans son nid perché au sommet de la cheminée. Tu es debout pieds joints, les bras pendant le long du corps.
Tu plies la jambe droite et tu appliques la plante du pied contre la cuisse gauche.
Avec tes mains, tu amènes la plante du pied le plus près possible de l’aine et tu la gardes ainsi. Le genou est tourné sur le côté.
Tu places les paumes de tes mains l’une contre l’autre puis tu lèves les mains à la verticale au-dessus de la tête.
Tu conserves cette attitude aussi longtemps que tu peux en respirant profondément et en fixant ton regard sur un point.
Tu glisses lentement le pied et les mains vers le bas et tu reviens à la position normale.
Tu refais le même exercice du pied gauche.
Tu recommences deux fois tout l’exercice. Si tu le réussis bien, tu te sens détendu(e).
La cigogne renforce le sens de l’équilibre, rectifie la démarche et la tenue. Cet exercice assouplit les muscles des jambes, il est excellent pour la concentration et pour la bonne humeur.
D’après “Yoga pour enfants” K.et P. Zebroli
Image et citation du… dimanche !

À l’encontre de beaucoup de personnes que je pourrais nommer, je préfère m’introduire dans un compartiment déjà presque plein que dans un autre qui serait à peu près vide.
Pour plusieurs raisons. D’abord, ça embête les gens.
Êtes-vous comme moi ? j’adore embêter les gens, parce que les gens sont tous des sales types qui me dégoûtent.
En voilà des sales types, les gens !
Et puis, j’aime beaucoup entendre dire des bêtises autour de moi, et Dieu sait si les gens sont bêtes ! Avez- vous remarqué ?
Enfin, je préfère le compartiment plein au compartiment vide, parce que ce manque de confortable macère ma chair, blinde mon cœur, armure mon âme, en vue des rudes combats pour la vie (struggles for life).
Alphonse Allais / À se tordre (1891) / Œuvres anthumes — Alphonse Allais est un journaliste, écrivain et humoriste français né le 20 octobre 1854 à Honfleur (Calvados) et mort le 28 octobre 1905 à Paris. Célèbre à la Belle Époque, reconnu pour sa plume acerbe et son humour absurde, il est notamment renommé pour ses calembours et ses vers holorimes. Il est parfois considéré comme l′un des plus grands conteurs français. — Plus sur WikiPedia.